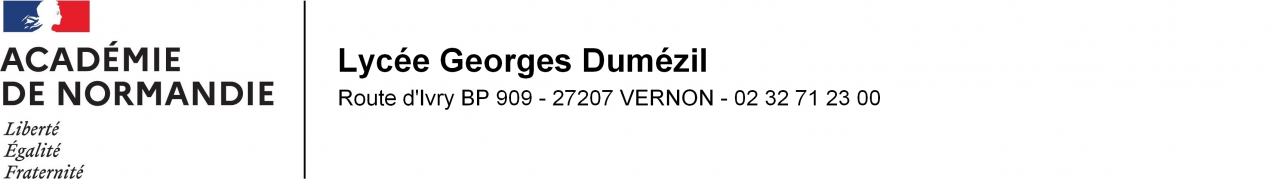Georges Dumézil
Fils d’un officier d’origine bordelaise, Georges Dumézil naquit le 4 mars 1898 à Paris. Après des études au Collège de Neufchâteau, aux Lycées de Troyes et de Tarbes puis au Lycée Louis-Le-Grand, il entra en 1916 à l’École Normale Supérieure. Après avoir passé quelques mois comme élève officier à Fontainebleau, il fut mobilisé au printemps 1917. A dix-neuf ans, Dumézil participa aux combats de 1917 et de 1918.
Après sa démobilisation, il passa l’agrégation de Lettres avant d’être nommé professeur au Lycée de Beauvais en 1920. Georges Dumézil rêvait d’un poste à l’étranger et, en 1921, il fut nommé lecteur à l’Université de Varsovie. Il y prépara sa thèse, Le Festin d’immortalité, sous la direction d’Antoine Meillet. Celle-ci fut soutenue en 1924, et l’année suivante, après son mariage, il choisit de partir en Turquie. Mustapha Kemal avait entendu dire que les chaires d’Histoire des religions avaient été un moyen de décléricaliser l’Université française. Il a donc décidé d’ouvrir une chaire d’Histoire des Religions à l’Université d’Istambul au sein même de la Faculté de théologie musulmane. C’est ainsi que j’ai été appelé en Turquie. Comme je n’avais pas envie de désislamiser ou de décléricaliser quoi que ce soit, je me suis arrangé pour que la chaire d’Histoire des religions soit, au bout d’un an, transférée à la Faculté des Lettres expliqua-t-il. Georges Dumézil passa six ans en Turquie. Il y découvrit les langues du Caucase et, en particulier l’oubykh, dont il entreprit l’étude.
En 1931, le philologue quitta la Turquie pour la Suède. Il devint en effet lecteur de français à l’Université d’Upsala où il se mit énergiquement aux études scandinaves. Il resta en Suède jusqu’en 1933.
A son retour en France, avec l’appui de Sylvain Lévi, il fut élu directeur d’études à l’École pratique des Hautes Études, Ve section, pour l’étude comparative des religions des peuples indo-européens. Il occupa ce poste de 1935 à 1968. Parallèlement, le Collège de France l’accueillit, créant pour lui une chaire de civilisation indo-européenne. Il y enseigna jusqu’à sa retraite en 1968.
L’historien des religions passa ensuite trois années aux États-Unis, enseignant à Princeton, Chicago, Los Angeles. Doué d’une culture encyclopédique, Georges Dumézil connaissait une vingtaine de langues, du grec au gallois, du sanskrit à l’ossète, du latin au suédois, du persan au russe et au turc. De nombreuses universités avaient honoré cet érudit en le nommant Docteur honoris causa.
Le grand linguiste fut élu à l’Académie française le 26 octobre 1978 au fauteuil de Jacques Chastenet. A sa demande, c’est Claude Lévi-Strauss qui prononça le discours de réception sous la coupole.
Georges Dumézil est décédé à Paris le 11 octobre 1986.
A Vernon
A la veille de la Seconde guerre mondiale, Georges Dumézil avait fait l’acquisition d’une maison située à Vernonnet, rue du Mont Roberge. Dans ses Entretiens avec Didier Eribon (Folio, Gallimard, 1987), il raconte dans quelles conditions : comme on la voyait venir, cette deuxième guerre, je me suis d’abord occupé de mettre ma famille à l’abri. J’achetai à la hâte, au printemps 1939, une maison à Vernon, en me disant que si Paris était détruit par l’aviation allemande, cette petite ville subsisterait. Nous nous y installâmes en juin, pour les vacances.
En juillet l’ordre de mobilisation arriva Capitaine de réserve, Dumézil fut envoyé successivement à Liège, à Beyrouth puis Clermont-Ferrand. Démobilisé en 1940, il vint en zone occupée : à Paris, je retrouvai ma famille qui venait juste de rentrer après s’être réfugiée dans le Midi. Car si Paris était intact, Vernon, bombardé un jour de marché, avait été détruit aux deux tiers.
Après la guerre, chaque été, le chercheur et sa famille quittaient l’appartement parisien de la rue Notre-Dame des Champs et venaient passer trois mois à Vernonnet, en général du 15 juin au 15 septembre. Mais il s’agissait de vacances studieuses ; les témoins l’affirment : l’érudit travaillait toujours.
Avant guerre, Georges Dumézil recevait quelques amis à Vernonnet, notamment l’éditeur Gaston Gallimard, son voisin de Pressagny l’Orgueilleux. Plus tard, l’époux de sa fille Perrine, Hubert Curien, devenu Ministre de la recherche y faisait étape en venant visiter la Société européenne de propulsion. Les Dumézil entretenaient de bons rapports avec leur voisinage, en particulier avec la famille Bouquet.
En 1962, le philologue qui était retourné en Turquie pour ses recherches, reçut à Istambul deux jeunes vernonnais Jean-Pierre Bouquet et Guy Brébion, ancien professeur au Lycée de Vernon. Hébergés à l’ambassade de France, ils accompagnèrent le chercheur dans ses enquêtes auprès des populations turques.
A la fin de sa vie, Georges Dumézil venait plus rarement dans sa maison de la rue du Mont Roberge.
Les prêtres, les guerriers et les paysans
Georges Dumézil a profondément marqué les recherches consacrées à la civilisation indo-européenne. Il fut en effet le premier à montrer que l’ensemble indo-européen constitue certes d’abord une famille de langues mais qu’un fonds culturel commun et une même conception de la société réunissait les peuples qui, dans l’Antiquité ou le haut Moyen Age, s’exprimaient dans ces langues.
Menant une étude comparative des religions, des mythes, des modes de pensée rencontrés dans la communauté indo-européenne, Dumézil constata chez ces peuples une même organisation de la société. Celle-ci est divisée en trois groupes rituellement séparés exerçant des fonctions spécifiques : au sommet, les spécialistes du sacré, au-dessus, ceux qui maîtrisent l’art militaire, enfin, à la base, ceux qui travaillent pour nourrir la collectivité. Dans l’ensemble indo-européen, on trouve toujours trois castes distinctes : les prêtres, les guerriers et les producteurs, essentiellement des paysans.
Cette représentation de la société, à laquelle Georges Dumézil a donné le nom d’idéologie tripartite, il l’a retrouvée dans le symbolisme mythique et religieux des peuples indo-européens, notamment dans les triades de dieux qui caractérisaient leurs religions anciennes. Dumézil expliquait : Il me semble difficile qu’une civilisation ait pu forger cette représentation tripartite sans avoir été effectivement organisée en trois classes distinctes qu’en simplifiant on pourrait appeler prêtres, guerriers et paysans. Je crois donc à une origine sociale de cette idéologie. Ce n’est évidemment qu’une hypothèse, puisque nous n’avons aucun témoignage direct sur les Indo-européens. Mais quelle autre hypothèse serait vraisemblable ? (Le Monde, 12 avril 1985).
Formulée pour la première fois dans Mythes et dieux des Germains (1939), cette vision de la civilisation indo-européenne a été enrichie par la Religion romaine archaïque (1966), Idées romaines (1969), mais surtout Mythe et épopée (1968-1973), trois volumes qui constituent une synthèse des travaux du chercheur.
Dans ses œuvres, Dumézil rassemble nombre de légendes, de contes, de mythes puis, ayant recours à une méthode comparative utilisée avec prudence, il s’efforce de montrer que l’organisation tripartite se retrouve aussi bien dans le monde caucasien que dans le Moyen-Age occidental ou en Scandinavie. L’historien des religions constate alors que certains mythes, transformés, sont repris dans des cycles romanesques ou poétiques.
Dans l’Inde ancienne, les trois fonctions sont représentées par les dieux Mitra et Varuna, Indra et les jumeaux Açvin.
Dans le monde scandinave, on retrouve Odin pour la souveraineté, Thor pour la guerre et Freyr pour les paysans.
Dans la Rome antique, la trifonctionnalité s’exprime à travers les trois dieux Jupiter, Mars et Quirinus.
Même organisation sociale dans le monde caucasien très étudié par Dumézil et dans le Moyen-âge occidental divisé en prêtres, chevaliers et paysans.
Claude Lévi-Strauss, recevant Georges Dumézil à l’Académie Française a souligné l’importance exceptionnelle de son œuvre : si l’idéologie tripartite éclaire des pans entiers du passé de nos civilisations, les démarches que vous avez suivies pour les mettre au jour intéressent, au-delà de l’histoire, l’ensemble des sciences humaines : avec la notion de transformation, que vous fûtes le premier d’entre nous à utiliser, vous leur avez donné le meilleur outil. Par la suite, il devait faire ses preuves sur d’autres chantiers. Il concluait : nous saluons un maître au savoir plus qu’encyclopédique dont le génie a su établir, entre des domaines restés jusqu’alors chasses jalousement gardées des spécialistes, des rapprochements qui bouleversent tout ce qu’on croyait savoir d’un passé lointain et qui ouvrent aussi des perspectives entièrement neuves sur la dynamique de l’esprit humain.
Tout à la fois linguiste, historien des religions, archéologue et ethnographe, Dumézil fut avant tout un chercheur ayant consacré sa vie à l’étude des aspects linguistiques et mythologiques des civilisations indo-européennes. Il a laissé une oeuvre colossale - plus de cinquante ouvrages - et solitaire, édifiée peu à peu en dehors des écoles et des systèmes. En effet l’inventeur de la nouvelle mythologie comparée s’est toujours refusé à fonder une nouvelle discipline ou une nouvelle doctrine scientifique. Je ne suis pas un maître à penser confiait-il à la fin de ses entretiens avec Didier Eribon.
BIBLIOGRAPHIE
Les oeuvres de Georges Dumézil ont été publiées chez Gallimard.
1941 - JUPITER, MARS, QUIRINUS (Essai sur la conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome)
1942 - HORACE ET LES CURIACES
1943 - SERVIUS ET LA FORTUNE
1944 - NAISSANCE DE ROME (Jupiter, Mars, Quirinus II)
1946 - NAISSANCE D’ARCHANGES (Jupiter, Mars, Quirinus III)
1947 -TARPEIA (Essais de philologie comparative indo-européenne)
1948 - MIIRA-VARUNA (Essai sur deux représentations indo-européennes de la souveraineté)
1949 - L’HERITAGE INDO-EUROPEEN A ROME (Introduction aux séries Jupiter, Mars, Quirinus et Les Mythes romains)
1969 - IDEES ROMAINES
1968 - MYTHES ET EPOPEE, tome I
1971 - MYTHE ET EPOPEE, tome II
1973 - MYTHE ET EPOPEE, tome III
1977 - LES DIEUX SOUVERAINS DES INDO-EUROPEENS
1982 - APOLLON SONORE et autres essais
1984 - LE MOYNE NOIR EN GRIS DEDANS VARENNES
1984 - LA COURTISANE ET LES SEIGNEURS COLORES
1985 - L’OUBLI DE L’HOMME ET L’HONNEUR DES DIEUX